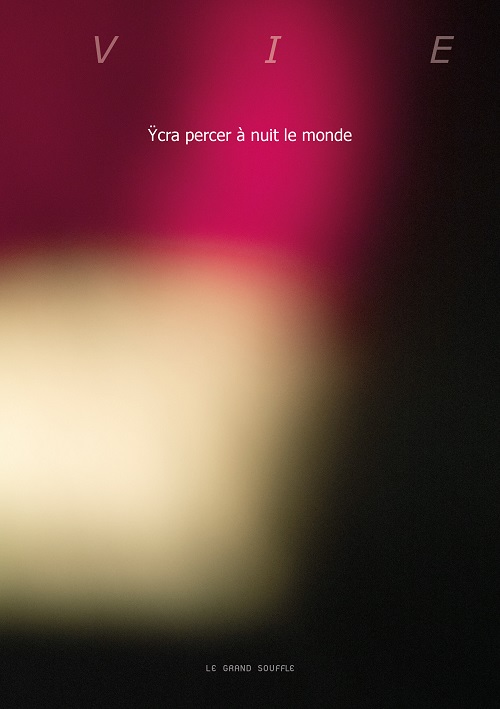
J'avoue : il m'a fallu un bon mois pour atteindre la centre-quatre-vingt-huitième page de ce second volet du cycle en cinq tomes de V I E. Et cette lenteur est due à plusieurs facteurs : un manque de temps long qui me faisait lire le soir, à raison de moins de dix pages par séance ; une trop grande confiance en mes capacités de lecture puisque j'ai déjà lu et apprécié l'écriture de François Richard ; un degré plus haut dans la destruction-création stylistique voulue par l'auteur.
Heureusement, pour m'aider dans ma quête, j'ai eu la chance de lire en parallèle le recueil La Littérature Inquiète de Benoît Vincent – et qu'il en soit ici remercié car il m'a permis de prendre du recul pour mieux appréhender ce qui se jouait. Puisqu'on est dans les remerciements, je tiens aussi à souligner le travail et l'engagement de l'équipe d'artistes qui ont fondé les Éditions du Grand Souffle et qui défendent l'originalité envers et contre tous. Bravo à eux d'avoir osé publier ce livre ; en ces temps de concentration de l'univers de l'édition, c'est plus qu'une action courageuse : un Manifeste.
François poursuit donc son cycle V I E et on retrouve une grande partie des personnages du tome 1. Réveillés et amnésiques, plusieurs voyagent géographiquement ou spirituellement (ou temporellement ?) pour comprendre ce qui arrive, pourquoi ça arrive et ce qui les attend. Ils ont quitté le squat-cité abandonnée de Ribardy et se rendent compte que d'autres lieux ont aussi eu maille à partir avec la surveillance des autorités.
La musique, les sons et des textes magiques peuvent modifier l'état de ce monde dystopique. Des chanteurs de rue sont capables de déprogrammer les esprits avec des mélodies qui font comme des courts-circuits. C'est l'air de Noé, parfois associé au joueur de flûte, qu'on retrouve aussi sur des graffitis ou qu'on peut tenter de capter par un walkman. Phrases, mélodies et couleurs (celles des iris de deux personnages au moins) peuvent de la même manière altérer et réconcilier les personnalités. Un homme aurait lâché plusieurs enfants-anges dans le monde avec des moyens différents pour aboutir à la même révolte. De ce que je pense comprendre...
Peu à peu, des bribes reviennent : René-Hans se souvient ou bien anticipe sa rencontre avec sa sœur Audèl, des dialogues mordent dans l'imaginaire médiéval du Graal, dans celui de Blade Runner, dans le surréalisme du Coup De Dé, dans Les Ailes Du Désir, Le Transperce-Neige, Indiana Jones, voire Un Jour Sans Fin : tout est bon pour déconstruire notre rapport au Réel. Les enfants Monarch des années 1940 sont un appui, les vraies années 1970 sont citées avec leurs villes nouvelles. Et on est au début du XXIème siècle.
La fin de ce volume affirme la nécessité des bars et tavernes, ces lieux où défaire, refaire des mondes et délirer à plusieurs. La fin des temps approche tandis qu'on s'interroge sur le Créateur suprême, sans savoir exactement qui sont ces jeunes lâchés dans le monde, ces poètes qui résistent et ce qui se planque dans la perspective secrète si on regarde légèrement à droite vers le bas. Eux ont fait le choix de vivre à fond, de danser, courir ou jeter des fleurs de nuit. Ils écoutent leur émotivité primordiale et trouveront sans doute une phrase qui sonnerait comme un accord ultime et sauverait l'Humanité.
Ce qui est troublant avec ce livre, c'est la manière dont François Richard hache et recompose la langue, créant des néologismes, se moquant de la ponctuation et cassant la syntaxe. Ce n'est ni de la prose, ni de la prose poétique au sens que lui construit le XXème siècle (après Aloysius Bertrand, bien sûr). La langue danse à son tour, attendant ou mimant cette musique salvatrice. Elle est comme une langue étrangère qu'on réapprendrait, conscient qu'elle a une signification sans pour autant tout saisir. C'est comme un univers et une langue parallèles, à la manière des multivers (re)mis au goût du jour. L'auteur le sait, c'est l'un de ses points d'ancrage puisqu'il cite un "livre de fer", un autre livre, Nina, des invocations poèmes, une chanson-slam. C'est sérieux malgré tout, puisque le cortex de l'univers tient grâce aux poètes de la Terre.
Le lecteur se trouve alors pris comme les personnages dans un monde dont il ne saisit pas le sens global (si tant est que le monde ait un sens) et c'est difficile d'accepter de perdre pied, de ne pas contrôler et de lire à la façon d'un trip. Il faut tolérer de se laisser porter par ce style, comme on le fait avec le Lynch de Mulholland Drive ou avec la musique, car lorsqu'on en écoute, nous n'avons pas besoin de la signification. Avec ce texte, il en va souvent de même : les sonorités et les images générées peuvent suffire, à condition de s'envoyer en l'air avec plusieurs pages de suite (en gros, d'après mon expérience, c'est à la cinquième page successive que j'admets cette posture étrange de ne pas pouvoir suivre). Une citation parmi d'autres donne le LA : "nous avons maîtrisé nos geôliers en parlant une langue qu'ils ne comprenaient pas et qui tombait du ciel." Alors, oui, il a raison Noroil de dire qu'il est "le personnage d'un livre qui brûle".
Pour paraphraser Benoît Vincent au sujet d'Arno Bertina : il faut accepter de se laisser porter par la voix de l'auteur, abandonner la rambarde rassurante du récit et les garde-fous du langage. En affirmant sa langue et en tenant malgré tout son récit, François s'enfonce dans une nuit qu'il sait noire mais au bout de laquelle il a sa lumière. De cette torche, il incendiera plus qu'il n'éclairera l'avenir de cette vieille forme qu'est le roman.
Arrivé en fin de chronique, je sais que ce livre n'est pas pour tous ; il sera conseillé aux curieux qui aimeraient découvrir de nouvelles formes, audacieuses, décalées, provocatrices, mais belles de par leur singularité et leur torsion du monde.
"Jamais la météorologie ne détruira l'horloge. Pas ceux de son bois. René-Hans, en chacune de ses cellules et de son lignage, conscientise comme autant de connexions du centre à la peau, que dans l'atelier d'horloger où il avait été gisant il avait entendu la réunion des maîtres, dans la pièce d'à côté.
De là, d'avant même le début, je pense qu'il pressentait la forme de l'impression d'envergure qu'il laisserait, lorsqu'il retrouverait cet état de gisant, après la marche, la très longue marche La marche comme le titre d'un film à sa mémoire ou le récit du poète à la forme de l'impression finale duquel on bâtira une église dont la puissance analogue forera l'œil lecteur jusquà la cécité vermeil"