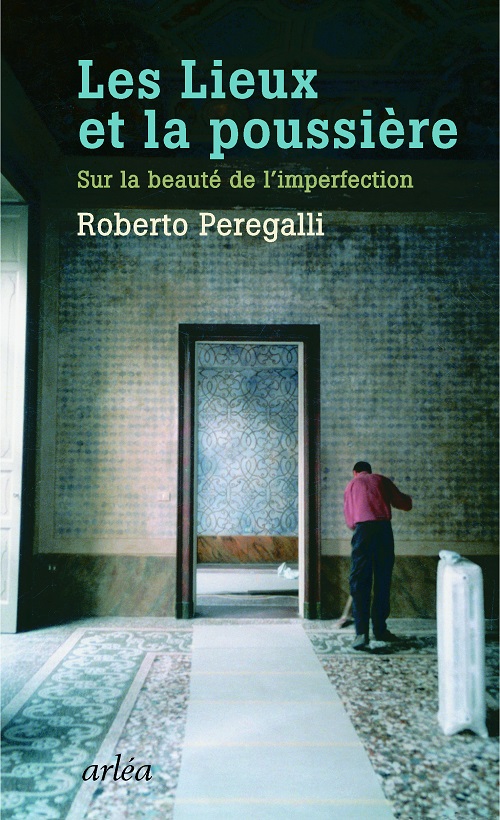
Que faire des lieux lorsque leur utilité n’est plus aussi évidente et prégnante qu’autrefois, lorsque le temps s’est endormi, que leurs occupants sont partis ? Roberto Peregalli, philosophe et architecte italien, nous livre un essai dont le propos pourra heurter notre sensibilité très française, culturellement marquée par la doctrine d’Eugène Viollet le Duc (1814-1879) qui prônait une restauration systématique des monuments, quitte à ne pas respecter leur passé. L’auteur se range ici nettement du côté des partisans de John Ruskin, historien d’art britannique (1819-1900) qui préconisait une préservation des traces du passé en veillant à protéger le vieil édifice de toute cause de délabrement. Pour lui, "il est impossible, aussi impossible que de ressusciter les morts, de restaurer ce qui fut grand ou beau en architecture." Le sort ultime d'un monument est donc de disparaître : "sa dernière heure enfin sonnera ; mais qu'elle sonne ouvertement et franchement, et qu'aucune substitution déshonorante et mensongère ne le vienne priver des devoirs funèbres du souvenir" (dans "Les sept Lampes de l’Architecture"). Le style, passionné, a incontestablement quelque chose à voir, sur la forme et le fond, avec le propos de Roberto Peregalli qui nous livre une formidable réflexion sur le rapport au temps et à la mémoire.
Le philosophe italien commence par asséner une idée maîtresse qu’il ne lâche plus jusqu’à la fin de son texte : le temps passé n’est pas une matière révolue de nos vies. Le temps ne reviendra plus, certes, mais il continue de remplir notre existence. Nos souvenirs s’inscrivent dans l’espace, forment la trame de ce qui nous constitue. Le temps marque l’espace de son empreinte, finit par poser des couches qui sédimentent et confèrent aux lieux une certaine épaisseur, un magnétisme, une aura qu’il ne faudrait pas briser.
Au fil de courts chapitres, Roberto Peregalli revient sur les principes qui ont historiquement conditionné l’habitat et caractérisé l’habiter des hommes. Il s’emploie à fustiger cette époque qui entend mêler transparence et désir de spectacle, qui n’aspire qu’à la lumière, comme en témoigne cette obsession de baies vitrées où chacun se met en scène et s’offre au regard du passant. L’auteur rappelle que finistra signifie étymologiquement fin de l’extérieur et que les ouvertures étroites comme les murs constituent depuis toujours des refuges nécessaires au repos et aux pensées. Car l’homme a besoin d’ombre, de recoins, de bougie, de mélancolie. On retrouve avec plaisir la référence à "l’éloge de l’ombre" du maître japonais Tanizaki...
A cet appel aux forces obscures s’ajoute une invitation à l’humilité qui passe chez Roberto Peregalli par une critique virulente de l’ère urbaine du XXIème siècle caractérisée par le triomphe des constructions mégalomanes. Certes les grands monuments existent depuis longtemps mais ils étaient selon lui dictés par le besoin de montrer un chemin, un au-delà. Il ne s’agissait pas là de caprices d’architectes "boursouflés d’arrogance et de présomption" dont les constructions solitaires viennent dans nos villes modernes ruiner des espaces de mémoire et de silence. Ces nouveaux bâtiments "ne savent pas écouter ce que demandent les lieux […], ce qu’ils veulent, c’est uniquement nous déconcerter." Selon lui, les architectes contemporains inventent des mausolées d’abord destinés à leur propre gloire avant même de savoir à quoi ils serviront, et la signature est leur obsession. Il accuse ces nouveaux édifices de vouloir s’emparer des quartiers comme des gens qui l’habitent.
La critique particulièrement mordante de Roberto Peregalli trouvera sans aucun doute un écho auprès de ceux d’entre nous, poètes, romantiques, vagabonds, amoureux de l’abandon (de la désolation, du suranné, du démodé, du vide souverain…) qui regrettent la disparation de ces "contre espaces" (pour faire référence à Foucault) sous les assauts des politiques d’aménagement conduites par des acteurs électoralement jugés en fonction de leur capacité à repaver des places, à détruire des zones "insalubres", à supprimer toute "verrue" d’un paysage urbain qui aspire désormais à devenir clinique.
Le philosophe italien évoque les conséquences de cette ère du marketing territorial où les villes s’envisagent comme des vitrines : on ne laisse plus dans nos tissus urbains la place à des parcelles en ruine, à des surfaces en friche si propices au mystère et aux déambulations poétiques. Pourtant ces lieux nous fascinent parce qu’ils nous ressemblent : leur fragilité est leur force, ils sont des remparts contre le rendement et l’arrogance du pouvoir. Ces lieux renvoient à l’éphémère, à notre mortalité. Ils sont des pauses dans la course effrénée du temps, ils constituent des espaces-temps nécessaires "comme le silence dans une partition musicale" (p 93). Ils nous offrent enfin une vision plus large d’un monde où tout n’est pas encore joué d’avance. Là où l’aménagement enferme, l’espace délaissé devient une réserve de possible où pousse ce qui est spontané. La ruine dispose d’une certaine manière d’un caractère révolutionnaire car elle est une faille qui fait douter le système, qui conteste la norme.
Il y a donc une beauté, une aura propre à ces parcelles terrestres ("certains lieux anonymes sont dans la lumière parce qu’ils sont à l’abandon", p 90). Il y a aussi une utilité, parce que cette ruine enchante notre monde, parce qu’elle devient abri, espace nécessaire de suspens et d’échappée au sein du quotidien. Ces lieux "tristes" sont l’ombre de notre vie, une ombre dont nous avons besoin. Ils évoquent le fragile, l’inconstance des choses, la beauté de l’instant, le silence. Il faut prendre en considération cette mélancolie, et par conséquent protéger la ruine avant qu’elle ne se dégrade. Ces lieux ont une valeur inestimable, que l’on ne peut pas acheter ("on ne peut acheter la durée des choses dans le temps", p 118)
Il s’agit donc d’accepter le temps qui passe : ne pas le nier, savoir au contraire en apprécier les marques et les rides. Ne pas céder à cette ère où les corps comme les édifices sont soumis à cette dictature de la beauté clinique où le sourire devient figé et le regard absent ; "nous préférons ce corps absent, poli et sans défaut, sans ombre, à l’abandon de la peau et de la chair aux caprices du temps" (p 119) regrette l’auteur qui souligne encore que "si un corps nous attire, nous excite, si nous le désirons, si nous avons le souffle suspendu devant ses recoins les plus secrets, son odeur, sa surface, sa couleur, c’est par sa consistance qui change avec les années et s’adapte à nous et au monde" (p 120). Soyons respectueux des marques laissées par le temps, respectueux de la vie des personnes qui ont habité ces endroits, respectueux des ombres et du passé qui peuplent nos vies, de la chair dont nous sommes faits.
Le lecteur jugera que les critiques de Roberto Peregalli sont peut-être un peu trop systématiques et négatives à l’égard du monde actuel. Mais le propos vigoureux, excessif et lyrique à souhait, s’avère particulièrement bienvenu dans une ère où l’adhésion béate à l’urbanisme grandiloquent semble de mise.